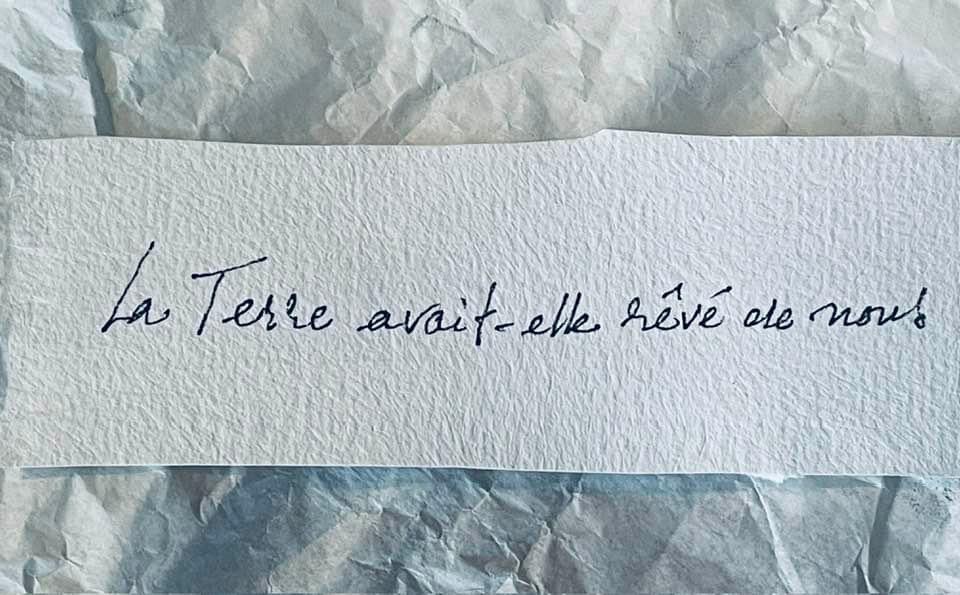je laisse mes doigts courir:
le ciel fait des tiennes rayonne et poudroie de cristaux et de givres. des rideaux glissent s’envolent. bouchées de gris sale comme plâtrées d’écumes les heures blanches s’alignent et nous mangent nous mâchent le dos la main par le front dévoré la fontanelle ouverte les yeux rivés devant la grande étoile du jour
une oscillation immense balance les isthmes de pierres fondamentales (tu dirais « montagnes » ou « rocheuses »), les peuples-forêts respirants et tapissés de mycorhizes, ses vigiles attentives, les océans profonds habités d’animaux inconnus et dépeuplés des connus, les lignées de créatures vivantes dotées de fourrure et d’ailes, d’insectes préhistoriques, et les hommes malades de pouvoir et de destruction. elle balance dans ses signes et ses odeurs nos mythes et nos erreurs, la folie des croyances, nos peurs
errants dans tout cet espace, accrochés à la lune, à l’étoile, tournent la saison le monde la pensée la vie. tournent nos villes et nos jardins. et plus grand que nous, plus vaste, tournent les étranges planètes compagnonnes d’un tout petit système solaire propulsé vers tout l’inconnu
devant les grands mouvements des poulies du ciel, comment les êtres auront-ils inventés la pensée d’un immuable insensé (ou incensé) alors que tout fait un sens si gigantesque, comment auront-ils eu l’idée de se penser en quelque pouvoir que ce soit, qui plus est illusoire, quand ils vivent sans comprendre ni percevoir l’extraordinaire même du fait d’exister, ici maintenant, quelque part sur la Terre, où la seule égalité réelle est celle de l’équinoxe entre deux solstices
* … *
*
je suis pour l’égalité, les montagnes sont égales à la mer
je suis pour l’égalité, les forêts sont égales aux êtres
je suis pour l’égalité, les libellules sont égales aux fleurs
je suis pour l’égalité, les caribous sont égaux à un peuple
je suis pour l’égalité, les slips sont égaux aux slips
je suis pour l’égalité, l’humain est égal à lui-même
je suis pour l’égalité, l’humain n’est pas qu’homme
*
* … *
mais ce n’est pas égal, la vie. la planète contre les humains, les humains contre la planète, ce n’est ni égal ni loyal ni juste. cette lutte qui l’inventa, qui l’entretient, qui croit un tel mode de pensée — livrer bataille à sa propre planète, n’est-ce pas imbécile et autant que de s’attacher une bombe au corps délibérément — : je remets en question la supposée supériorité des humains et les mets au défi de sauver le monde de la stupidité destructrice ancestrale
qui change la pensée qui l’ouvre vers le futur …
nous ne sommes que des témoins dans une course à relais, soit, nous recevons le bâton-vivant pour en être les porteurs d’une génération à l’autre, soit, mais pour le transmettre d’une génération à l’autre : qu’est-il transmit, l’angoisse ou la joie
* … *
*
post scriptum :
El Niño cuit des oies à froid
je répète:
El Niño cuit des oies à froid
les renards du jardin festoient
il y aura des plumes et du sang
sur les fleurs sauvages ce printemps
…